
Quilombo, cimarron, quesako?
- Les sociétés rebelles affranchies -
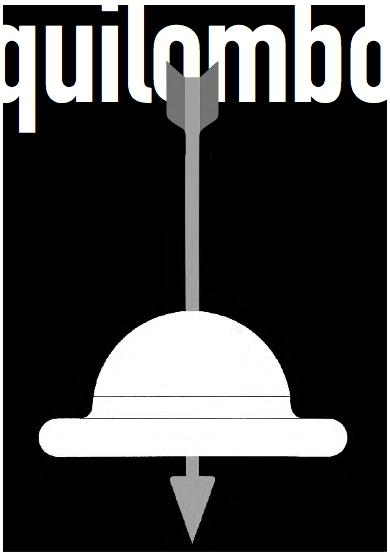
 |
Quilombo, cimarron, quesako? - Les sociétés rebelles affranchies - |
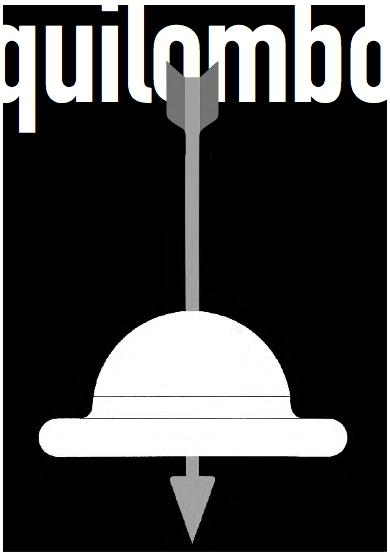 |
|
Le mot “marron” vient de l'espagnol “cimarron”,
qui veut dire sauvage. Il définit les
esclaves insoumis qui parvenaient à s'enfuir dans la nature,
Avec le cacique (chef de tribu amérindien des Antilles) Enriquillo , des indigènes et des noirs s’unirent pour lutter dans le Bahoruco (La Espanola) de 1519 à 1533. D'autres luttes se déroulèrent sous le commandement du cacique Lampira au Honduras en 1538, du cacique Bayano au Panama en 1548, du roi Miguel au Venezuela en 1552 et du cacique Guaicaipuro au Venezuela entre 1561 et 1568. Les plus tenaces dans leur résistance furent les Karibs et les Black Karibs de l'archipel orientale. |
|
En Guadeloupe, les Karibs
tuèrent et blessèrent, en 1625, des jésuites qui voulaient les évangéliser.
La résistance de ces fugitifs «Cimarrons» s'intensifia dans la forêt guyanaise
et
en Jamaïque où débuta, en 1655, la première guerre des «maroons ». À Cuba (El Cobre),
à Sainte-Croix, en Guadeloupe et à Antigua, vers 1731-1740, les noirs rebelles
firent souffler un grand vent de liberté. Mais c'est en Jamaïque et au Suriname
de 1739 à 1749 que les conflits armés se terminèrent par la victoire des
«Marrons ». Les autorités anglaises et hollandaises durent même négocier et
signer des traités de paix. C'est au
L'analyse de ces révoltes nécessite parfois des explications anthropologiques (stratégies de lutte, arts, musique, langues, religion). Elle permet de comprendre par exemple la vie des « cimarrons » dans le Quilombo dos Palmares (Brésil) au XVIIe siècle, et l'avènement du chef Zumbi. Ce personnage reste une icône de la résistance anti-esclavagiste et anticolonialiste, et un héros pour la communauté afro-brésilienne au Brésil et en Amérique latine en général. Dans ce lieu de résistance aux structures de l’oppression coloniale, autonomes et inexpugnables, noirs, métisses, indiens et blancs non catholiques s’y organisèrent pour fonder une république libre. La république de Palmarès sera la seule à cultiver en pluriculture dans un environnement de monoculture de sucre. Elle organisera des guérillas de libération d’esclaves. Chacun ne devenait libre que lorsqu’il avait lui-même libéré un autre esclave. La tradition orale des Caraïbes nous porte aujourd'hui quelques échos de cette période à travers contes, chants et proverbes. Mais il existe encore des habitudes, des traumatismes qui se transmettent de générations en générations, une sphère idéologique autour des langues créoles, des valeurs particulières qui se retrouve dans la culture orale des îles des Antilles et du continent latino-américain. |